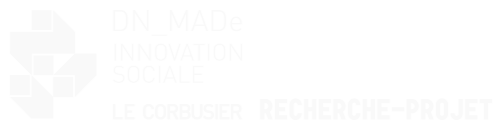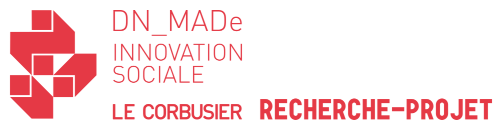Quelle est votre vision d’un futur désirable ?
Les réponses à cette question sont certainement nombreuses, et vastes. Mais serait-ce un monde où nous sommes impuissant.e.s au quotidien face à nos problématiques sociétales et environnementales croissantes ? Face à tous ces défis, comment persévérer vers l’élaboration d’un avenir souhaitable ? C’est la réflexion qui me mène vers le sujet de la résilience collective.
La résilience collective est la capacité d’un groupe ou d’une société à s’adapter et se transformer pour faire face à des situations de crises diverses, notamment environnementales. Ainsi, elle s’ancre dans une approche systémique et se crée grâce aux interactions des individus et différents acteurs du groupe.
Les low-techs ont une définition ouverte mais on peut les caractériser selon des principes qui reviennent de manière récurrente tels que l’accessibilité (technique, financière, physique), la durabilité, la sobriété, l’autonomie, l’utilité et bien d’autres. Ils peuvent donc autant qualifier des systèmes techniques que des modes de vie ou des courants de pensées. Plus simplement, c’est une démarche qui invite à remettre en question nos besoins et les ressources que nous utilisons au quotidien pour créer des systèmes techniques. Selon l’ADEME, les low-techs sont un ensemble d’approches résolument systémiques s’inscrivant dans une perspective d’autonomie, d’autosuffisance, d’adaptabilité, de transformabilité et de résiliences territoriales.
Par conséquent, cet écrit tente d’éclaircir comment le design peut outiller la résilience collective, en intégrant une démarche low-tech. Pour se faire, trois thématiques essentielles seront abordées. Pourquoi la résilience collective se considère-t-elle à une échelle locale ? Comment mettre en place un contexte favorable à son développement à l’aide d’outils ouverts et collaboratifs ? De quelles manières peut-elle se matérialiser au quotidien ?
[photo]
1 – S’ANCRER. Les projets locaux réduisent la vulnérabilité du territoire en l’adaptant aux caractéristiques locales, comme le climat. L’architecture vernaculaire est un exemple de la façon dont les populations ont développé des solutions adaptées à leur territoire au fil du temps. Les solutions techniques doivent venir des communautés elles-mêmes, de leurs besoins, de leur culture technique et de leurs compétences. Les savoirs sont forgés grâce aux expériences concrètes d’individus, en interaction avec leurs environnement, leurs compétences, leurs besoins et leurs outils. Les systèmes techniques doivent être pluriels et situés plutôt qu’universels. La diversité technique favorise la résilience territoriale.
2 – DÉMOCRATISER. Créer un réseau communautaire est essentiel pour favoriser l’entraide, la collaboration et le lien social. Ces réseaux peuvent partager des ressources techniques et des réflexions collectives en constante évolution. La mise en réseau et le partage des compétences sont importants dans le mouvement de résilience. Les formes techniques doivent permettre et autoriser l’adaptation. La plupart des objets sont conçus pour être obsolètes et pour masquer leur fonctionnement. L’ouverture d’un objet permet d’observer, de comprendre, de reproduire et de modifier son fonctionnement. Avoir accès au savoir technique permet d’avoir un pouvoir d’interaction et d’adopter une posture active dans son rapport à l’objet et à son environnement. La standardisation peut être utile pour rendre une approche plus accessible et éviter les initiatives isolées. La standardisation crée une base commune qui n’empêche pas la diversité des techniques, car elle peut évoluer différemment selon les territoires et les communautés.
3 – ÉTENDRE. L’adaptation à des situations imprévues est une première étape vers de nouvelles pratiques. Le détournement, qui permet de changer son regard sur son environnement de manière à pouvoir l’altérer pour s’adapter, est une autre manière de s’adapter à des imprévus. L’expérimentation est une pratique qui consiste à apprendre ou découvrir à partir de l’expérience, personnelle ou scientifique. Dans le cadre de cette recherche-action, l’expérimentation viserait à expérimenter en groupes des systèmes ouverts de manière collaborative. Elle pourrait participer à la formation de lien social, par la technique, à l’exploration des spécificités de son territoire et au développement de compétences techniques par le biais de la transmission par les pairs, afin d’entretenir ou reformer des cultures techniques locales.